Le temps de la sédation profonde est presque terminé.
Un choix stratégique a été opéré : le confinement.
Il a été socialement accepté malgré son coût économique exceptionnel.
Un choix de sortie de crise a été décidé : des protocoles sanitaires contraignants.
Sont-ils en passe d’être acceptés ?
Qu’est-ce qu’une bonne décision ?
C’est une décision négociée, qui, de ce fait, entraîne l’adhésion.
Pour que la décision soit acceptée encore faut-il qu’elle soit en phase avec les intérêts de ceux qui l’acceptent. A fortiori, quand un intérêt devient prioritaire par rapport à un autre.
Entre deux intérêts il a fallu choisir : sauvegarder la santé du plus grand nombre et ne pas sacrifier l’économie.
Le confinement, stratégie choisie par de nombreux gouvernements a réussi à sauver des vies mais il a durablement sapé les fondements du plein-emploi.
Pourquoi les Français ont-ils accepté le confinement ?
Peut-être et même certainement par peur.
Au-delà du mode de gestion de cette crise, que certains appellent catastrophe[1], le problème de l’absence de négociation démocratique continue à être posé.
Comme dans une entreprise dans laquelle on ne ferait pas confiance aux initiatives des salariés, on s’est méfié des citoyens et on a décidé de règles communes pour tout le territoire de la République, une et indivisible car l’égalité ne se négocie pas.
C’est la liberté et la fraternité qui en ont pris pour leur grade.
Certains, dont Aurore Bergé, députée LRM, avaient identifié le problème à résoudre :
Si l’on veut contrer l’épidémie et que les Français appliquent strictement les règles, il est nécessaire qu’elles soient claires, expliquées, mais aussi qu’elles soient jugées justes et proportionnées.»
En effet, l’ADN de nos dirigeants est constitué d’une valeur profondément ancrée depuis la Révolution et le Bonapartisme : l’égalité de tous les citoyens. Au nom de cette égalité désirée et non réelle, il faut produire des décisions, des normes valables pour tous, sans exception.
D’ailleurs l’exception, c’est le diable !
Cynthia Fleury, philosophe,[2]réagit sur les questions liées à la gestion de l’épidémie en regrettant trois attitudes:
- L’absence de délibération dans la production de normes.
« Cela va jusqu’à des délires sur le statique le dynamique, le métro oui et le parc non.
Il y a un manque de discernement car nous avons confiné la délibération commune ».
- La volonté de faire le bien pour tous.
« Au nom de la sécurité, du bon sens, de la protection des uns et des autres, on pratique une surveillance qui relève du dictatorial et du liberticide. »
« La bien-surveillance c’est la dangerosité de vouloir à tout prix faire le bien” . Dans un premier temps chacun pense que c’était normal, on accepte la restriction de liberté ; et le danger des états d’exception c’est de s’accoutumer, il y a le risque d’être zélé. »
- L’infantilisation
Les Français ont-ils été infantilisés ?
« La réponse est oui : il y a eu un manque de discernement. C’est compliqué de trouver le juste niveau de langage pour faire prendre conscience de quelque chose de grave et ne pas verser dans la paranoïa.”
« Dans les moments de crise, on découvre très vite qu’on ne peut pas imposer de règles communes. “Par l’application d’une règle commune très générale, vous ne faites que renforcer les vulnérabilités.”
Elle suggère de repartir de la base pour prendre des décisions efficaces.
Qu’attendre du Ségur de la santé qui s’ouvre pour réformer le système hospitalier ?
« C’est très simple’‘, répond la philosophe, ” les soignants le disent, il faut faire ce qu’on a fait pendant la crise du coronavirus, desserrer la pression gestionnaire. On n’a pas demandé d’avoir des malades rentables, on a permis aux médecins de recruter ».
Il est vrai que ce qu’a démontré la crise est sur certains plans positif:
- Les professionnels ont réussi à s’organiser sur le terrain en dehors des strates bureaucratiques.
- Les équipes de terrain, ont révélées leur capacité d’engagement, de réactivité et de créativité et l’importance primordiale de leur expérience.
- Des pratiques anciennes et oubliées ont été réinventées.
La peur de ne plus avoir d’emploi va-t-elle supplanter la peur de mourir ?
Aujourd’hui le champ de ruines économiques est devant nous. Certains économistes diront que le nombre important de demandeurs d’emploi supplémentaires correspond à peu près à ceux qui travaillaient dans les secteurs précarisés et uberisés et qu’ainsi la crise épidémique a joué un rôle de révélateur de la fragilité de la croissance française.
La peur de l’autre va-t-elle supplanter la peur économique ?
La crise épidémique a révélé les transformations en cours depuis plusieurs décennies :
- Perte de la dimension collective du travail, institutionnelle, relationnelle, existentielle.
- Le travail est devenu une activité isolée, digitalisé…
Au lieu de mener à bien des projets collectifs où l’on coopère ensemble, on a assisté à l’émergence d’usagers solitaires qui effectuent des taches ou des missions sous la supervision de managers censés les coordonner avec une vision globale qu’ils n’avaient en réalité que de manière partielle.
Le télétravail fortement conseillé pendant le confinement devient la forme de production de valeur préférée des Français. Pourquoi ?
En infusant dans la sphère privée et familiale il a contribué à plusieurs phénomènes:
- Pour certains, la satisfaction de la mise en parenthèse de toute vie sociale avec une extinction de la conflictualité.
- Un déphasage avec les rythmes communs.
- L’immersion dans des univers virtuels mettant de côté la réalité extérieure et les enjeux interpersonnels.
- L’absence de perspective en rapport avec des formes d’altérité.
Et pourtant, 73% des français souhaitent poursuivre le télétravail au-delà de la situation épidémique.
Certains groupes familiaux ont de plus en plus tendance à prolonger un confinement volontaire fondé non seulement sur la peur de la contagion mais sur le confort de la bulle familiale, sur le registre de l’indifférenciation, de la récusation des tiers…
La question posée par le déconfinement est :
- Comment, ces personnes qui ont eu un ressenti positif du confinement et du télétravail, seront-elles aptes à pouvoir réinvestir des liens, à s’intégrer dans des dynamiques collectives, à affirmer leur place au niveau social ?
Il y a eu une sédation temporaire.
Le réveil risque d’être brutal et amer.
Les plans sociaux ; la demande de sécurité sanitaire ; les réflexes juridiques tels, mise en cause pénale des dirigeants, utilisation de droits de retraits ; la production de protocoles sanitaires tout azimuts; autant de signaux négatifs qui augurent mal d’une reprise économique rapide, que ce soit comme le monde d’avant ou avec le monde d’après…
En parallèle, la réaction des agences et institutions étatiques, inquiètes de la situation épidémique imprévue ont réagi en deux temps :
- Se mettre à l’abri en énonçant des avertissements culpabilisateurs et policiers.
- Se défausser de toutes responsabilités en produisant des textes réglementaires sophistiqués, précis et inapplicables sur le terrain (exemple des 58 pages pour l’Éducation nationale).[4]
Préserver la dignité de nos pratiques, c’est parfois résister aux injonctions aliénantes, à la destruction de nos singularités, à l’uniformisation managériale de nos représentations, actes et discours.
Barbara Stiegler, une autre philosophe, est persuadée que l’on pense à partir de ce qui nous dérange, on s’organise politiquement et collectivement à partir de ce qui nous pose problème et de ce qui nous fait souffrir.
Les directives abstraites d’experts s’appliquant sans vécu rétroactif sont vouées à être inefficientes sur le plan des pratiques.
Elle imagine un monde dans lequel les décideurs devraient expérimenter leurs idées en travaillant pendant des périodes données sur les terrains de leurs décisions.
Comme pendant la Grande Révolution, Girondins, Montagnards et Cordeliers sont à l’œuvre pour prendre le pouvoir sans nous dire qu’en faire pendant que le monde de la grande entreprise se prépare au business as usual.
Commençons donc à demander aux maires, aux présidents de départements et de régions, aux présidents d’université, aux proviseurs et directeurs d’école, aux usagers de tous les secteurs économiques de produire leurs propres protocoles sanitaires plutôt que de laisser les préfets les appliquer à leur bon vouloir.
Yves HALIFA
30 mai 2020
[1]Boris Cyrulnik, par exemple, considère que l’on doit nommer CRISE, une situation grave passagère, et que nous sommes en face d’une CATASTROPHE, quand l’après n’est plus comme l’avant.
[2]Membre du Comité national consultatif d’éthique, interrogée sur France inter :
[3]Professeure de philosophie politique à l’Université Bordeaux Montaigne, membre de l’Institut universitaire de France et responsable du Master « Soin, éthique et santé »
[4]Long de 58 pages, il détaille l’accueil des élèves, l’aménagement des classes, la récréation, la gestion de la cantine… Tout y est listé pour tenter de guider les différents rectorats en prévision de l’après 11-mai, où la reprise des classes devrait se faire progressivement, par niveaux. Si le nombre de règles est impressionnant, leur application posequestion. Ce sera, en grande partie, aux établissements scolaires de s’organiser.

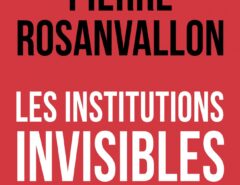


Laisser un commentaire